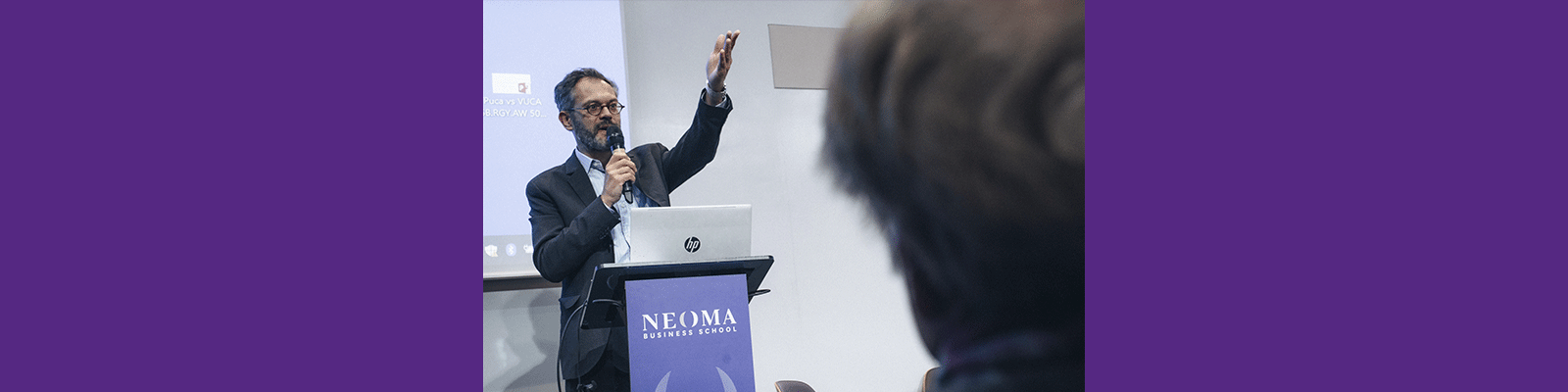La gestion se remet en question
Publié le 13/03/2025
La gestion se remet en question
Publié le 13/03/2025
Comment les outils et dispositifs de la gestion se sont-ils diffusés dans la société durant les dernières décennies ? En effet, les méthodes de gestion, plans stratégiques, indicateurs de performance, processus d’organisation, sont désormais omniprésents dans les hôpitaux, les universités, et même dans nos vies personnelles. C’est la « managérialisation » de la société.
Régis Martineau a analysé sur une longue période l’évolution des outils de gestion, montrant qu’il existait depuis la naissance du management au début du 20e siècle une oscillation entre des outils plutôt « fermés » (les outils qui visent à contrôler et normer les comportements) et des outils plutôt « ouverts » (les outils qui laissent davantage d’autonomie aux acteurs). Franck Aggeri et Sébastien Gand ont montré tout l’intérêt que pouvait avoir la notion de « dispositif » proposé par Michel Foucault. En effet, les indicateurs de performance, tableaux de suivi, contrôles… ne sont pas neutres : ils façonnent nos comportements et nos décisions, souvent sans que nous en ayons conscience. Ils nous poussent à adopter une logique de contrôle et d’évaluation permanente, transformant notre rapport au travail et à la société. Enfin, Christopher Midler et ses collègues ont montré comment la notion de projet s’était très largement diffusée au sein des entreprises et de nos sociétés. Nous nous fixons des objectifs, suivons un plan, mesurons les résultats… : tout fonctionne comme si nous étions en permanence en train de gérer des projets, que ce soit dans les entreprises, les institutions ou même notre quotidien. Christopher Midler parle d’une « projectification » du monde.
Les bouleversements technologiques, climatiques, démocratiques poussent aujourd’hui à repenser l’entreprise. Trois pistes possibles.
Thomas Loillier a plaidé pour l’avènement d’une entreprise « naturelle », afin que celle-ci soit compatible avec les enjeux de l’anthropocène. L’idée est notamment de sortir d’un modèle basé sur l’exploitation infinie des ressources pour adopter un fonctionnement plus durable et respectueux des écosystèmes. Justine Arnoud, Rémi Bourguignon et Philipe Lorino ont défendu l’idée qu’il fallait développer plus de démocratie en entreprise. Inspirés par le pragmatisme (une philosophie qui privilégie l’expérience et l’adaptation aux réalités concrètes), ils plaident pour des organisations où les employés participent davantage aux décisions, plutôt que tout soit décidé par une petite élite dirigeante. Cela permettrait des entreprises plus justes, plus efficaces et mieux adaptées aux défis d’aujourd’hui. L’IA transforme les métiers, les modes de production et la prise de décision, ce qui oblige les entreprises à repenser leur organisation et leur rapport au travail humain. Dejan Glavas a mis en évidence la rupture que constituait l’avènement de cette technologie. Elle pose aussi des défis éthiques (remplacement des emplois, prise de décision automatisée) mais aussi des opportunités (gains d’efficacité, innovations).
Alors que l’on parle de « terminal marketing », sous-entendu qu’il est arrivé à une impasse, Bernard Cova défend une autre vision : il propose un « marketing societing », c’est-à-dire un marketing qui ne se contente pas de vendre des produits, mais qui prend en compte la société et ses besoins. Après avoir retracé l’histoire des approches comptables, Bernard Colasse a mis en perspective l’avènement récent d’une comptabilité engagée. Celle-ci ne se limite plus à compter l’argent qui rentre et qui sort, mais intègre désormais des critères sociaux et environnementaux (par exemple, mesurer l’impact écologique d’une entreprise et pas seulement ses bénéfices). Enfin, Julienne Brabet et Patrick Gilbert ont plaidé pour une GRH non plus sur la performance financière, mais plutôt sur l’activité humaine, en mettant en avant le bien-être, la motivation et le développement des compétences des travailleurs.
Cette journée a marqué une étape clé dans l’histoire de la RFG, confirmant son rôle essentiel dans la réflexion académique et managériale francophone.
Le programme des 50 ans de la Revue française de gestion
La journée a réuni 150 personnes de la communauté francophone des sciences de gestion et du management. Les six débats ont porté sur les multiples enjeux auxquels les organisations et le management font face. 1) Décrypter et historiciser la managérialisation de nos sociétés ; 2) Repenser l’entreprise à l’heure de l’IA et des crises démocratiques et climatiques ; 3) Faire sortir les sciences de gestion et du management de leur « ghetto » académique ; 4) Repenser les méthodologies en sciences de gestion et du management ; 5) Réenchanter et repenser le monde grâce à un management plus esthétique et créatif ; 6) Réinventer les sciences de gestion et du management à l’aide de trois regards disciplinaires (marketing, comptabilité, GRH).
Les échanges donneront lieu à un numéro spécial qui paraîtra en fin d’année.