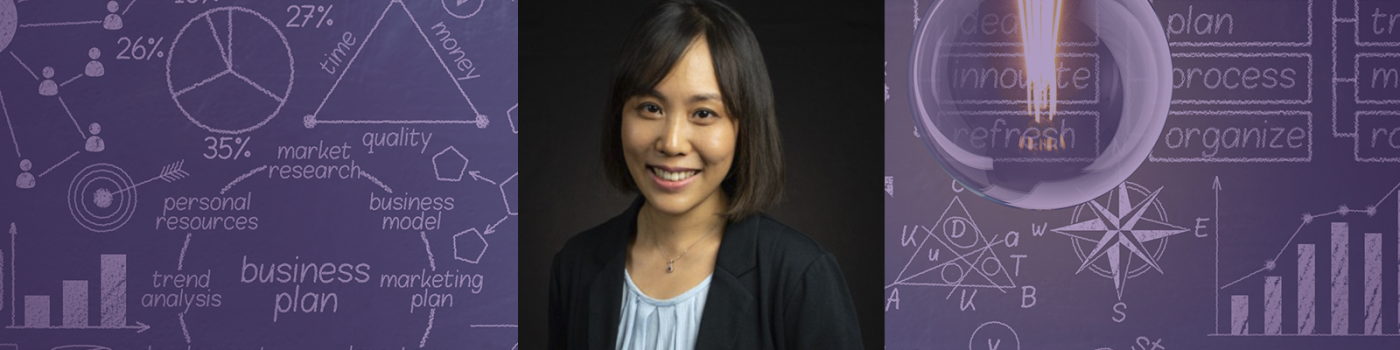Et si, pour une femme, gagner plus que son conjoint freinait… sa propre carrière ?
Publié le 31/07/2025
D’après une étude de trois chercheurs, dont Hyejin Yu, professeure assistante à NEOMA Business School, réalisée auprès de milliers de couples hétérosexuels en Australie pendant plus de 20 ans, les inégalités de revenus freinent la carrière des femmes… même lorsqu’elles ont de meilleurs revenus que leurs compagnons.
Elles sont techniciennes, cadres supérieures ou entrepreneuses. Elles touchent de bons salaires et gagnent même mieux leur vie que leur mari. Pourtant elles auront tendance à refuser une promotion, un nouveau poste mieux payé, une mission challengeante, et donc à stagner dans leur travail, pendant que leurs compagnons gravissent un à un les échelons professionnels. C’est le constat surprenant d’une vaste étude conduite sur 7 252 couples hétérosexuels en Australie, sur plus de 20 ans, codirigée par Hyejin Yu, professeure assistante dans le département « People & Organisations » à NEOMA Business School.
Il était déjà connu que les femmes gagnent en moyenne moins d’argent que leurs conjoints, et que cela tend à brider leur évolution professionnelle : parce qu’il faut trouver une solution de garde, s’occuper de tâches administratives et domestiques, ou encore déménager pour permettre au conjoint d’accepter une mutation, beaucoup acceptent de rogner sur leur propre carrière afin que le foyer perçoive, in fine, le plus d’argent possible. Or cette vaste étude démontre que ce raisonnement ne suffit pas à expliquer les faits. Si c’était le cas, les rôles s’inverseraient en même temps que les niveaux de rémunération. Or les femmes qui gagnent plus que leur mari restent désavantagées, au même titre que celles qui ont de moins bons revenus. Seuls les couples dont les rémunérations sont équivalentes se démarquent.
Une menace symbolique qui pèse sur l’identité masculine
De manière générale, les femmes prennent plus de tâches domestiques en charge – cuisine, ménage, lessive… – lorsque les revenus sont déséquilibrés. Si une logique traditionnelle prévaut lorsque l’homme gagne mieux sa vie, l’étude montre qu’un autre mécanisme s’enclenche dans le cas contraire : le conjoint e se sent menacé, remis en question dans sa masculinité et son aptitude à subvenir aux besoin du foyer. Les compagnes ont alors tendance à le sentir et à faire des efforts, même inconscients, pour les rassurer et les préserver, notamment en endossant un rôle traditionnel de « fée du logis ». Déjà prises par un travail prenant et exigeant, elles en viennent ainsi à subir une éreintante double journée et finissent par se désengager professionnellement.
Pour expliquer cette dynamique, l’étude s’appuie – outre son vaste corpus de données – sur ce que les sociologues appellent la « théorie de la construction du genre ». Dans de nombreuses sociétés, des rôles traditionnels sont attribués aux individus selon leur sexe : l’homme a généralement une fonction de pourvoyeur économique, tandis que la femme est assignée à la gestion quotidienne du foyer. Lorsque des individus transgressent ces stéréotypes, cela crée une dissonance dans le couple, pouvant être vécue comme une incongruité, une offense voire une menace – le plus souvent pour l’identité masculine, celle-ci étant par défaut avantagée… Pour rétablir un équilibre symbolique, certaines femmes « transgressives » ont donc tendance à surjouer d’autres stéréotypes de genre : par exemple en s’occupant davantage de la maison ou en se définissant comme des mères attentionnées, plutôt que comme cheffes de famille. Ce mécanisme, le plus souvent inconscient, contribue à les éloigner d’une belle carrière.
L’égalité appelle l’égalité
Le poids des stéréotypes de genre est d’autant plus frappant que les hommes ne sont pas du tout affectés de la même façon : qu’ils gagnent plus ou moins que leur conjointe, leurs chances d’obtenir une promotion restent stables, et leur carrière suit peu ou prou la même trajectoire. Autrement dit, les logiques de compensation domestique pèsent uniquement sur les femmes.
En revanche, il existe un cas de figure où cette tendance à « construire le genre » s’étiole : lorsque les revenus sont relativement égaux au sein du couple. Dans cette configuration, souligne l’étude, les femmes ont le plus de chances de progresser dans leur carrière. Il y a moins de tension symbolique au sein du foyer, moins de compensation domestique, et une répartition plus équilibrée des tâches à la maison.
Pour autant, tous les couples « égalitaires » ne sont pas logés à la même enseigne. Le niveau global de revenus du foyer modifie aussi les comportements. Lorsque les conjoints font partie de la classe moyenne ou supérieure, les hommes participent davantage aux tâches ménagères. Surtout, ils sont plus enclins à endosser des rôles perçus comme féminins (faire la cuisine, le ménage…) sans le vivre comme une menace pour leur masculinité. Cependant, dans les couples aux revenus faibles mais équilibrés, les hommes s’investissent moins dans les tâches domestiques. Ils ressentent davantage le besoin de jouer un rôle de pourvoyeur économique pour rester de « vrais hommes », à leurs yeux ou celui de leur entourage. De même, les femmes de ces foyers continuent de s’impliquer massivement dans les tâches domestiques, même lorsqu’elles contribuent de façon significative aux revenus du ménage. Autrement dit, les inégalités de revenus nourrissent une inégalité dans les tâches domestiques, qui elle-même freine la carrière des femmes — un enchaînement qui ne concerne pas les hommes.
On en parle ?
L’étude montre ainsi que l’égalité des chances au travail reste un idéal encore lointain. Si les inégalités se sont réduites ces dernières années, l’évolution reste lente. Cela tient notamment à la manière dont les couples concilient le travail et la vie familiale. En conclusion, les chercheurs et chercheuses donnent donc plusieurs recommandations : à l’échelle des couples, l’essentiel est d’abord de… discuter ! Parler explicitement et concrètement des tâches quotidiennes, de la répartition des rôles, de ce que chacun veut et attend de son travail, sont autant de premiers pas essentiels pour prendre conscience des dynamiques de genre et du poids des stéréotypes. Lorsque les revenus sont élevés, relève l’étude, le recours à des aides à domicile (pour le ménage par exemple) est également une façon de favoriser l’égalité des trajectoires professionnelles.
Pour autant la bonne volonté ne suffit pas. Les couples sont aussi engagés dans des dynamiques économiques et sociales qui les dépassent. C’est pourquoi l’étude plaide aussi pour jouer sur des leviers politiques : en développant des congés parentaux véritablement équitables, et en instaurant davantage de transparence salariale au travail par exemple. Changer les mentalités ne se fera pas du jour au lendemain, mais c’est une condition nécessaire pour que les femmes puissent s’épanouir pleinement dans leur carrière, au même titre que les hommes.
En savoir plus
Hyejin (Elise) Yu, Alexis Nicole Smith et Nikolaos Dimotakis, Dollars and Domestic Duties: A 22-Year Study of Income, Home Labor, and Gendered Career Outcomes in Dual-Earner Couples, Journal of Organizational Behavior, mars 2025. DOI :10.1002/job.2879